Qui a dit qu’il ne se passe rien à Jarjayes ?
Après avoir obtenu l’aval et l’aide de la mairie de Jarjayes et de l’Association des Trois-Châteaux, le duo de musiciens composé de Marion Naudin (à la batterie) et Pierre-François Rillh (à la guitare) ont enregistré dans la chapelle des Trois-Chateaux de Jarjayes, en plein coeur de l’été 2022, un clip musical intitulé L’Udissea.
Ce morceau est compris dans le tout nouvel album ARNEV réalisé par Pierre-François Rillh (Nazha) sur le thème de la nature et du patrimoine avec la participation de Marion Naudin sur le titre Udissea.
Le lieu dominant les vallées de l’Avance et de la Durance et bénéficiant d’une vue à 180 degrés sur les montagnes environnantes, Céüse et le pic de Bure, a été soigneusement choisi par Marion Naudin.
Le tournage effectué à l’aide d’un drone à la lumière du soleil levant à permis de faire ressortir des images sublimes mises en valeur par un son de très grande qualité.
« Nazha est le nom d’artiste d’un compositeur musique de « rock instrumental », alliant guitares électriques saturées et mélodiques, basses puissantes et une batterie pleine de dynamisme.
L’album s’intitule « ARNEV » ce qui signifie « tempête » en breton, et vise à exprimer les remous intérieurs de nos émotions, de nos personnalités et des torrents de nos vies.
L’absence de parole, de voix et de chant est voulue, et permet au sens de l’artiste de se projeter de manière plus personnelle dans la musique, en y mettant nos propres sentiments et nos propres mots (et maux) intérieurs, sans qu’un interprète nous raconte une histoire avec sa propre voix.
Udissea, le titre enregistré et filmé en live en partenariat grâce à la commune de Jarjayes, est le 7ème titre de ce projet. Composé et enregistré à la batterie et à la guitare électrique, c’est à travers une Odyssée (Udissea !) musicale, à travers un voyage sonore mêlant des rythmes, sonorités et gammes changeantes que nous vous proposons de découvrir cet instant instrumental intense. La chapelle des Trois Châteaux est notre symbole de ce périple à travers la nature, vestige, dans la chaleur du soleil et les courants des airs ».

Les artistes se sont rencontrés au sein du projet de rock/métal alternatif Overcy en région parisienne.
Pierre-François Rillh est guitariste compositeur, professeur d’anglais âgé de 27 ans. Son nom d’artiste est Nazha, et il est l’auteur et le compositeur principal de l’album ARNEV.
Marion Naudin est batteuse compositrice, technicienne son Studio et Live. Elle est âgée de 23 ans et est originaire de la région.
L’association Trois-Châteaux a le grand plaisir de vous faire découvrir en avant première le clip musical tourné dans les ruines de la chapelle et remercie les artistes qui ont bien voulu le mettre aimablement à sa disposition.
Cliquez ici pour découvrir le clip
Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, voici un lien vers le compte de l’artiste Nazha donnant accès à tous les morceaux de l’album et aux liens le concernant sur les différents réseaux sociaux (instagram, YouTube, TikTok, AppleMusic, Spotify…):
linktr.ee/nazha_pf
Bonne écoute !

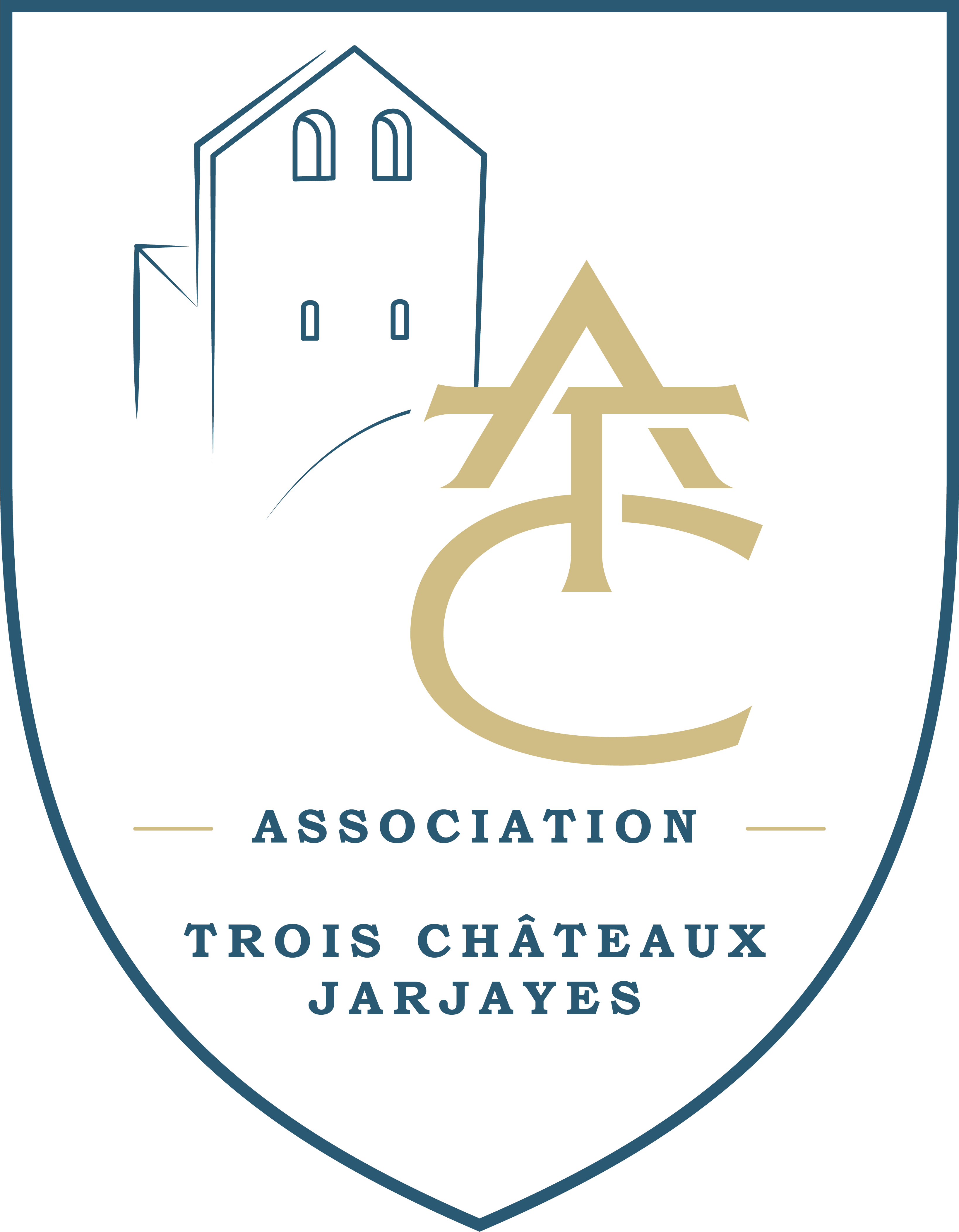


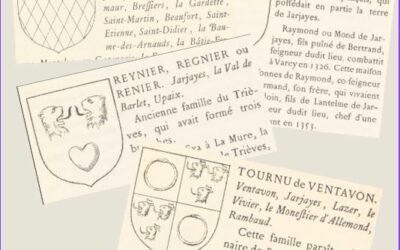
0 commentaires